Lundi. Toute la journée au bureau avec visites récurrentes de guêpes par le vélux et ponctuelle d’un informaticien (par la porte) qui réinitialise mon imprimante qui ne répondait plus depuis le retour des vacances. J’attaque la semaine par l’écriture de l’article “Geneviève Randon de Malboissière” destiné au Dictionnaire des femmes d’Ancien Régime à paraître chez Champion. Je complète ma documentation livresque par quelques interrogations internet (je m’intéressais au sujet bien avant Google) et m’aperçois que le livre de Dena Goodman est paru. Verdict des statistiques Word quand je boucle : 9000 signes pour 7500 TTC alloués ; j’élagaguerai demain. Déjeuner d’un sandwich au délicieux soleil de 14 h dans le jardin de l’Ecole – va et vient des nouveaux élèves qui prennent possession de leurs chambres ; parents de province qui accompagnent – origines dévoilées par les plaques minéralogiques des voitures dont les coffres se vident de cartons de livres, bouilloires électriques et un peu de linge. Je regarde les mères. Remontée au labo sous les toits, je découvre qu’une main providentielle – je ne sais à qui elle appartient -a disposé une assiette de mirabelles mûres à point près de la machine à café : riche idée. Echange de mails avec mes compagnes et compagnon de la fête des livres à La Ferté-Vidame hier pour nous réjouir de cette agréable journée champêtre et nous promettre de bientôt travailler ensemble. Je m’apercevrai plus tard qu’elles et il ont tout raconté sur leurs blogs. Rien à ajouter. J’aime l’idée qu’une semaine après cette insertion sur les terres du duc de Saint-Simon je foulerai les pelouses de la fête de l’Huma.
Mardi. Dans la cuisine, premier geste au matin : France Info. Je prends en marche une énumération des villes dans lesquelles des classes de collèges ou lycées sont fermées qui me laisse perplexe. Une classe de collège ou de lycée ça circule dans l’établissement pour rejoindre des salles spécialisées et ça se recompose au fil des heures au gré des options et des langues, quant aux profs, ils n’en ont pas qu’une de classe… Fermer une crèche je comprends, une classe de lycée nettement moins, surtout compte tenu de la virulence qu’on nous dit somme toute banale du virus dans l’état actuel des choses. La chaleur de retour ces jours-ci me semble bonne à prendre et je marche sur le large trottoir, côté numéros impair, du boulevard du Montparnasse, pile dans l’axe du soleil, entre la ligne droite grise de l’ombre des toits et celle, moutonnante, de l’ombre des frondaisons. On me dit toujours que je devrais couper par le Luxembourg pour aller de la gare à l’Ecole, mais je ne suis pas du tout fanatique de ce jardin, précisément parce qu’il est impossible à traverser en droite ligne. A l’approche du bassin, pas moyen de ne pas se dérouter. Assez mauvais souvenirs aussi de la fréquentation – les rares fois où c’est arrivé – des aires de jeux, balançoires, toboggans, poneys, petits bateaux, guignol et marchands de glaces ou gaufres quand les enfants étaient petits. Prénoms extravagants qu’on y entendait et parents insupportables qui allaient avec. Mon article sur Geneviève Randon de Malboissière, respectueux cette fois des normes typographiques, est parti, après que par un dernier acquis de conscience j’ai saisi sur Google le titre de son seul écrit publié. Une courte pièce Ilphys et Zulie que son maître d’allemand Michaël Huber a intégrée anonymement à un Choix de poésies allemandes publié en 1766. L’ouvrage que je n’ai jamais réussi à voir à la BnF, existe numérisé par Google : j’en suis toute retournée – mais je ne le retrouve pas au moment d’insérer, j’y reviendrai quand j’aurai le temps .
Mercredi. Un peu en creux, pile au milieu de mes cinq jours ouvrables et troisième consécutif entièrement passé au bureau. Au vélux, outre les apparitions des guêpes qui continuent à entrer pour ressortir illico, visite du chat qui se promène sur les toits de l’Ecole, je le dissuade d’entrer malgré ma profonde sympathie pour la gente féline ; pas trop content d’être éconduit, il aurait tôt fait de mordre. La BnF fermée pour son grand ménage annuel, les historiens se replient dans leurs quartiers, s’occupent d’affaires organisationnelles, de programmes, de calendriers, de réservation de salles, de demandes de moyens pour 2010. Autant de choses dévorant de plus en plus de temps. La satisfaction tout de même, et profonde, de voir si bien reçue ma proposition d’écriture en réponse à une sollicitation reçue hier soir et qui m’a fait particulièrement plaisir. Affaire rondement menée et deadline au 28 septembre, soit bien proche pour quelque chose d’aussi nouveau… Tous ces jours à venir, donc, avancer de deux heures mon réveil. Notre bachelier de l’année, travailleur saisonnier dans une librairie-papèterie du quartier latin, pas fâché d’arriver samedi au terme de son contrat, rentre à 20h50 claironnant : “Plus que deux jours !”. Rude premier contact avec le monde du travail que d’éprouver à 17 ans la fatigue de journées longues de sept heures passées impérativement debout dans un sous-sol non climatisé, en août-septembre, à recharger des piles de paquets de copies, doubles, simples, perforées, non perforées, à petits carreaux, à grands carreaux, et j’en passe, 21X29,7 ou 29X32.
Jeudi. “Retour de la grouse” proclame la pancarte du restaurant au coin de la rue de la République à Vanves vue du bus 189. Je sais peu de choses de la grouse, que je classe néanmoins parmi les volatiles. L’annonce tend à me faire penser que celui-ci est saisonnier, mais j’ignore absolument où la grouse peut bien se nicher quand elle n’est pas dans une casserole à Vanves. Reçue de 12 à 14 heures par la bibliothèque d’un Comité d’établissement banquier pour y parler d’Atelier 62 avec des lecteurs, dans le cadre du prix littéraire inter-CE, j’y suis fort bien accueillie et en ressors avec un chouette bouquet de fleurs. Merci à tous. Sur le chemin du retour, je tente par deux fois de me procurer – enfin, depuis le temps que j’y pense – un iphone : rupture de stock. Je recharge donc une fois de plus mon compte mobicarte en attendant des jours meilleurs. Le iphone est appelé à résoudre d’une pierre deux coups mon problème de ipod (35 minutes, montre en main, d’autonomie de batterie, pourtant changée déjà une fois) et d’appareil photo qui a rendu l’âme. Il y a donc relative urgence (surtout pour les saisissements images du réel). Depuis peu, les gens des monuments nationaux m’invitent volontiers quand ils inaugurent quelque chose : aujourd’hui le carton est pour une expo “Splendeur de l’enluminure : le roi René et ses livres”, qui se tiendra bientôt à Angers, RSVP avant le 18 septembre. Mais désolée, ce sera non : un petit peu trop loin Angers, un petit peu trop à faire ici.
Vendredi. Journée au bureau, c’est ma “journée Hardy”, je travaille sur l’index des lieux du Journal de ce libraire parisien du XVIIIe siècle : un vrai bonheur la promenade “virtuelle” dans les rues du Paris de l’époque et tout ce qu’on y rencontre. L’école qui abrite mon bureau (mais dans laquelle je n’enseigne pas) s’anime chaque jour un peu plus. Rentrée pédagogique la semaine prochaine. N’étant pas ancienne élève du lieu, son monde et ses conditions protégées d’étudier me restent un peu étrangers. La fermeture de la BnF (encore une semaine) commence à me peser, parce que je voudrais jeter un oeil sur des journaux de mode des années 1950/60, un peu trop futiles pour l’érudite bibliothèque de l’Ecole. Je programme pour la semaine prochaine des expéditions à Marguerite-Durand et Forney (Forney je ne n’y suis jamais allée, ça m’en fera une de plus). La lettre des impôts, trouvée à mon retour à la maison, m’épate par sa parfaite bonne conscience. Alors que leurs services rectifient une erreur en ma défaveur qui leur est imputable à 100 % – oubli de saisie d’un chiffre - ils ont le culot de m’écrire IL VOUS A ETE ACCORDE UN DEGREVEMENT DE 448 EUROS. En capitales et pas question d’erreur ni encore moins d’excuses… Et encore heureux que je les avais calculés de mon côté mes impôts, parce qu’autrement j’étais bonne pour les payer les 448 € que je ne leur dois pas et DONT JE LES REMERCIE DE ME FAIRE GRACE DANS LEUR GRANDE BONTE… Je me couche tôt pour être en forme à la fête de l’Huma demain.
PS : je rassure tout de suite les fidèles du blog : ceci n’est pas un nouveau feuilleton du samedi (c’est juste parce que Libé ne me le demande pas)
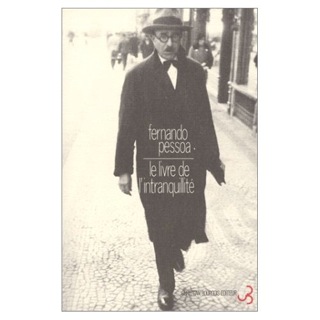









 P.S. Parce que ces temps-ci L’employée aux écritures manque d’image, n’ayant toujours pas eu le temps de régler son problème d’Olympus, ajout d’une photo, sans autre rapport avec le sujet que d’avoir été prise à Lyon et qu’on peut toujours dire que puisqu’elle n’est pas au forum Libé, la concierge est sans doute dans l’escalier.
P.S. Parce que ces temps-ci L’employée aux écritures manque d’image, n’ayant toujours pas eu le temps de régler son problème d’Olympus, ajout d’une photo, sans autre rapport avec le sujet que d’avoir été prise à Lyon et qu’on peut toujours dire que puisqu’elle n’est pas au forum Libé, la concierge est sans doute dans l’escalier.