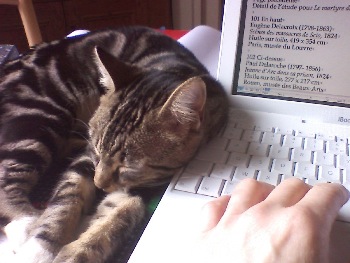Je continue à répondre à la question de François Bon.
Un deuxième temps très fort pour les lectures, ces années pendant lesquelles, outre apprentie historienne, je suis “collaboratrice occasionnelle à mi-temps” (ça existait !) à la Bibliothèque nationale 58 rue de Richelieu. Tous les matins nous sommes 4 ou 5 étudiants à trier, préclasser, classer et finalement intercaler des fiches dans les fichiers “Auteurs 1936-1959 et suppléments des années antérieures” et “Auteurs depuis 1970″.
La conservatrice responsable des fichiers auteurs et de l’équipe d’intercaleurs s’appelle Paulette Perec. Elle donne le la des lectures et des films consommés ensemble à très hautes doses (le cinéma ces années-là, c’était 3 ou 4 films par semaine) et qui alimentent nos conversations autour de la table sur laquelle se déversent d’énormes paquets de fiches à trous – les premières faites à l’ordinateur, livrées en vrac. Conversations qui se poursuivent dans les cafés autour de la BN (on a droit à une pause parce que la salle est souterraine), lors des dîners succulents dont Paulette nous régale régulièrement, et dans des maisons de vacances louées où l’on se retrouve encore.
A côté de Sarraute, Yourcenar, Perec (Georges, qui habite l’immeuble où ont lieu nos dîners, mais 2 étages plus bas), Flaubert et Maupassant – je suis très fière de mes premiers investissements pleiade : une fortune, ramené à ce que je gagne – qui accompagnent toujours, les découvertes majeures de ces années-là relèvent toutes de littératures étrangères.
Je lis latino-américain, à tour de bras. Cortazar, tout, au fil des traductions, préférence aux nouvelles ; Garcia Marquez, choc tellurique des Cent ans de solitude, espoir renouvelé à chaque nouvelle parution, mais non ; Alejo Carpentier, Siècle des Lumières et Partage des eaux en tête, mais aussi ceux à suivre ; Vargas Llosa grand plaisir avec La Tante Julia et le scribouillard, Borges évidemment, Aleph et Fictions d’abord. Tout ça Gallimard du monde entier ou folio si ça existe ; et Bioy Caseres, j’oublie la collection.
Mais je découvre aussi Isaac Bashevis Singer avec La famille Moskat (que je lis en ayant la grippe et de la fièvre au point que j’y vois double, mais je m’accroche), Yachar Kemal, avec Mémed le mince et Mémed le faucon, ou Kawabata, avec Le lac. De moins loin, je lis Svevo, La conscience de Zeno, et Handke, La femme gauchère en premier et Le malheur indifférent, Grass, Le tambour, et Boell, L’honneur perdu de Katarina Blum. Mais je n’accrocherai jamais à la littérature anglo-saxonne.
En 1980 mon contrat de collaboratrice occasionnelle à mi temps n’est pas renouvelé, mais je refuse mordicus d’aller m’inscrire au chômage et tout aussi mordicus de passer des concours. Vaches maigres, mais question formation, c’est bon.