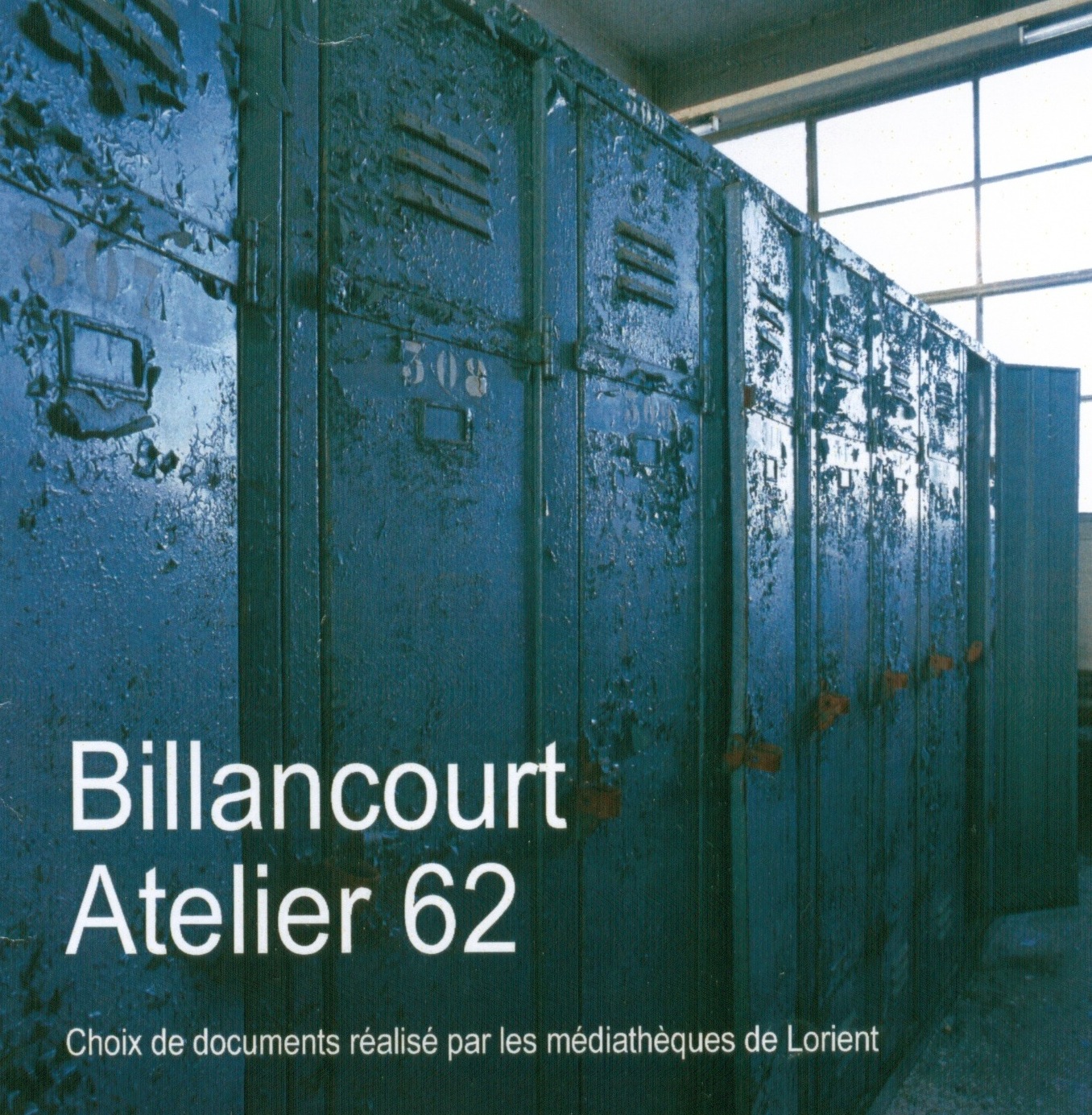Mis à part la récurrence d’interrogations sur les tripes et leur juste composition, les employées et les attentions aimables qu’on peut avoir à leur égard (Noël approche) et le pliage des serviettes en vue d’un dîner réussi (le réveillon de Noël approche) le mois dernier, par le truchement des moteurs de recherche, L’employée aux écritures a été saisie de quelques questions émergentes :
comment fabriquer un apéritif en novembre : personnellement, je fais comme en octobre, mais remplace les quetsches, dont ce n’est plus la saison, par des marrons et, par voie de conséquence, je fais cuire plus longtemps
le sens contraire du mot quasiment : j’avoue que je sèche lamentablement, ne parvenant même pas à imaginer que ce mot puisse avoir un sens contraire ni ce qu’il pourrait signifier
le patron d’une écharpe à coudre : la forme d’une écharpe est le plus souvent rectangulaire allongée et ne nécessite pas, de mon point de vue, le recours à un patron (mais je n’en ai jamais cousu, juste tricoté dans les années 1970, au point mousse, infiniment longues et rayées dans les tons violet/mauve/fuschia – ce que je ne saurais plus faire maintenant)
combien de femmes ecrivains en France : une petite poignée
quoi faire avec du bois de tilleul : du petit bois (la tisane se prépare avec les fleurs du tilleul, qui sentent si bon les soirs de juin)
la blonde train Sèvres rive gauche : je suis formelle, ce n’est pas moi, pourtant passagère assidue de la ligne ; les quelques mèches blondies 3 fois l’an ne sauraient prêter à confusion (sans compter qu’elles ne tiennent pas bien longtemps, surtout rapporté à leur coût)
une lettre écrite à un éditeur pour publier un sonnet : en 2007, j’ai bien écrit un certain nombre de lettres à un certain nombre d’éditeurs mais il ne s’agissait pas de publier un sonnet - juste la petite Sonnet comme dirait PB -, mais un texte plus long ; pour un seul sonnet, forme littéraire brève, je ne suis pas sûre que je me serais donné autant de peine (encore qu’un sonnet tienne sur une feuille A4 et pèse donc moins lourd qu’un manuscrit de 172 p., beaucoup plus onéreux en frais de port)
la présence de vipères à Oléron : en tout cas pas le 16 août après-midi à la librairie La pêche aux livres, ou alors elles étaient bien cachées, ailleurs dans l’île je ne sais pas, je ne la fréquente pas assez ; de façon générale je ne me soucie pas trop de leur présence, ayant l’habitude de séjourner dans des lieux montagnards où elles pullulent (je veux bien toutefois rappeler quelques règles élémentaires de prudence à leur égard : avoir de bonnes chaussures, marcher d’un pas franc – la résonance des vibrations suffisant en principe à les éloigner – et regarder s’il n’y en pas une qui dort avant de poser ses mains ou son séant sur un rocher)
un emploi maître nageur : les effectifs semblent au complet dans la piscine que je fréquente
le feuilleton sur la 3 le samedi : à ma connaissance, Montparnasse Monde n’a pas encore été adapté, mais continuez à surveiller les programmes TV, on ne sait jamais…




 le ciel est pareil.
le ciel est pareil.