A la veille de sa fermeture, il était bien temps, j’ai visité l’exposition des photos d’Irving Penn, ses Petits métiers, à la Fondation Cartier-Bresson. J’ai un peu regretté (et je n’étais pas la seule) que les tirages présentés soient si sombres. Fort contraste de ces “cris de Paris”, comme on les aurait appelés au XVIIIe siècle, sur les murs blancs des salles d’exposition.
Présent à Paris en 1950 pour photographier les défilés haute couture à la demande du magazine Vogue, Irving Penn en profite pour convoquer dans son studio de la rue de Vaugirard, en tenue de travail et avec tous leurs outils, des travailleurs et travailleuses repérés dans les rues de la capitale et dont il pense que les activités disparaîtront bientôt (il les dédommage du manque à gagner le temps de la pause).
La série des petits métiers amorcée à Paris est continuée à Londres et à New York selon les mêmes principes et c’est une “internationale ouvrière” que le photographe nous dresse, rejoignant August Sander et sa galerie des Hommes du XXe siècle ou François Kollar et son portrait de la France laborieuse à la veille du Front Populaire.
On peut, alors que l’exposition a fermé ses portes, retrouver les photos exposées (avec d’autres) dans le livre Irving Penn, Small Trades, qui faisait office de catalogue mais que je n’ai pas acheté. De ma visite à la Fondation Cartier-Bresson, un lieu collé au Montparnasse monde dans une impasse que je ne connaissais pas, impressions restées vives de
la maigreur du marchand de concombres : ses bras plus maigres que ses concombres, son tatouage d’un visage féminin (vague ressemblance avec Louise Brooks) dessiné sur ses côtes saillantes et le trou au genou droit de son pantalon ;
la bonne tête de l’équarisseur au chapeau : on irait presque confiant se mettre sous la scie qu’il tient à bout de bras ;
la complicité des deux garçons bouchers, se tenant par les épaules, et leurs longs tabliers chiffonnés maculés ;
l’invisibilité du technicien du gaz, visage dissimulé sous un masque à la technologie complexe, plein d’appendices, et la combinaison gommant son corps ;
la décontraction du soudeur, lui, le casque relevé, le masque baissé, et la jambe en avant ;
les chaussures impeccables du couple de cordonniers, elle et lui portant lunettes, et comme elle tient serré son mari ;
la fierté du terrassier, vieil homme portant veste et gilet, une main dans la poche du pantalon, l’autre posée sur l’extrêmité du manche de pioche ;
la lassitude du charpentier, un outil dans chaque main et un bout de planche serré sous chaque bras ;
le long collier-étalage du marchand d’oignons breton : si j’aimais les oignons c’est à lui, et à nul autre, que je me fournirais ;
l’air désabusé du réparateur de faïence, assis, tablier sur les genoux et dans chaque main un morceau à recoller ; ses outils et sa colle disposés au sol autour de lui ;
la concentration du couple de professeurs de danses de salon ;
les rayures des chaussettes et du pull du contorsionniste : mais comment son chapeau tient-il dans son improbable posture ? ;
les bas résilles de la danseuse de cabaret ;
les décorations arborées par le gardien de parc et les guerres qu’il a dû faire ;
le mètre ruban autour du cou de la couturière et la longue aiguillée de fil blanc piquée en haut de sa blouse noire ;
les plis impeccables du tablier de l’infirmière, la raideur de sa coiffe et de son col ;
toutes les épaisseurs superposées dont il faudrait venir à bout avant de parvenir à toucher enfin la peau du vendeur de peaux de chamois ;
le sourire en coin du chiffonnier ;
le sourire narquois du sommelier, sûr de la bonne bouteille qu’il tient en main, mais dont il sait bien qu’elle n’est pas pour nous ;
les mauvaises dents qu’on devine aux deux femmes de ménage se tenant par le bras et chacune son sceau en tôle, les brosses dedans, de l’autre côté.

(Et une fois n’est pas coutume : j’ai emprunté la photo sur un blog d’actualités photos de Los Angeles ; rien de plus facile que d’en trouver d’autres)

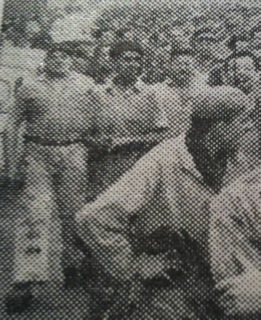



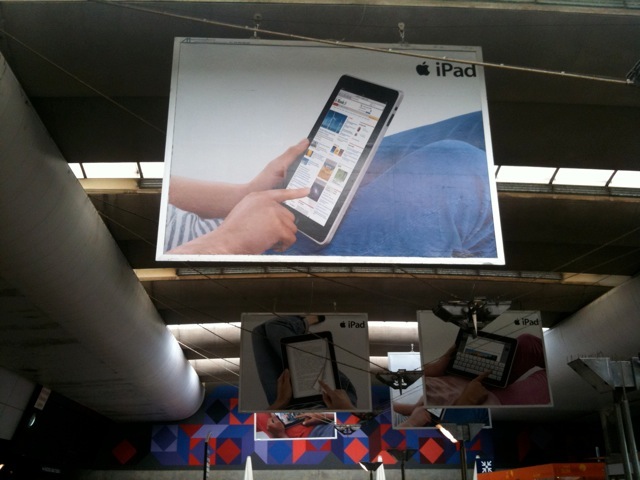







 Mais il leur manquait des cloisons et les remorques transportaient surtout du vide ; vide souligné, rendu criant même, par la présence d’un convecteur par pièce et d’une porte pour accéder à l’une d’entre elles seulement. Il faudrait donc disposer ces deux cases de façon à ce qu’elles communiquent. Convecteurs et porte suffisaient à ce que ces parallélépipèdes rectangles tronqués donnent acte de leur destination : se faire bureaux temporaires à la porte desquels il y aurait lieu de frapper avant d’entrer et où l’on pourrait passer l’hiver si la mission s’éternisait. Il y manquerait néanmoins un porte-manteau perroquet dans un angle à quoi suspendre son pardessus et son chapeau.
Mais il leur manquait des cloisons et les remorques transportaient surtout du vide ; vide souligné, rendu criant même, par la présence d’un convecteur par pièce et d’une porte pour accéder à l’une d’entre elles seulement. Il faudrait donc disposer ces deux cases de façon à ce qu’elles communiquent. Convecteurs et porte suffisaient à ce que ces parallélépipèdes rectangles tronqués donnent acte de leur destination : se faire bureaux temporaires à la porte desquels il y aurait lieu de frapper avant d’entrer et où l’on pourrait passer l’hiver si la mission s’éternisait. Il y manquerait néanmoins un porte-manteau perroquet dans un angle à quoi suspendre son pardessus et son chapeau.
